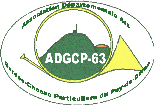Décret / Arrêté du 30 août 2006
Décret n°2006-1100 de 30 août 2006 relatif aux Gardes Particuliers Assermentés.
Complétant le code de Procédure Pénale et Modifiant le Code de l'Environnement et le Code Forestier.
Nouvelle Loi Chasse du 31-12-2008
Une nouvelle Loi sur la chasse vient de paraître, dans laquelle les Gardes-Chasse Particuliers n'ont pas été oubliés et applicable dés maintenant.
CHAPITRE III: DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRACTIONS
Article 9
I. -- L'article L. 428-21 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Ils sont habilités à procéder à la saisie du gibier tué à l'occasion des infractions qu'ils constatent et ils en font don à l'établissement de bienfaisance le plus proche ou le détruisent. "
L'Article L-428-21 contient ceci:
Article L428-21
Les gardes-chasse particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre qui portent préjudice aux détenteurs de droits de chasse qui les emploient. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
Ici s'insère la modification
A la demande des propriétaires et détenteurs de droit de chasse, une convention peut être passée entre eux et la fédération départementale des chasseurs dont ils sont membres pour que la garderie particulière de leurs terrains soit assurée par des agents de développement de cette fédération. Les agents ainsi nommés dans cette fonction par la fédération sont agréés par le représentant de l'Etat dans le département ; ils bénéficient des dispositions des deux premiers alinéas du présent article dans les limites des territoires dont ils assurent la garderie.
CHAPITRE VI: ALLEGEMENT DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES
Article 17
Pendant la période où la chasse est ouverte, le transport d'une partie du gibier mort soumis au plan de chasse est autorisé sans formalité par les titulaires d'un permis de chasser valide.
Article 18
L'utilisation du grand duc artificiel pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles est autorisée.
Législation: Les Chemins Ruraux
Textes de référence : articles L. 161-1 à L. 161-13 et R. 161-1 à R. 161-26 du Code rural
L'IDENTIFICATION DES CHEMINS RURAUX
Définition : les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales (article L. 161-1 du Code rural).
Il existe donc trois critères cumulatifs d'identification des chemins ruraux :
1 - Le chemin doit appartenir à la commune.
Ces chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune. La contestation quant à leur propriété relève donc de la compétence du juge judiciaire (article L. 161-4 du Code rural).
Le droit de propriété de la commune sur le chemin rural peut être fondé sur un titre ou être présumé. Ainsi tout chemin rural affecté à l'usage du public est présumé appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il se situe, sauf preuve contraire (article L. 161-3 du Code rural).
C'est à celui qui revendique la propriété du terrain concerné qu'il appartient d'apporter la preuve de celle-ci. Cette preuve peut résulter d'un titre de propriété sur le chemin mais également d'une prescription acquisitive revendiquée par le propriétaire.En effet, les chemins ruraux appartenant au domaine privé de la commune sont prescriptibles, contrairement aux voies communales.
La prescription est un mode d'acquisition de la propriété reposant sur l'écoulement d'un certain laps de temps pendant lequel une personne possède alors que le propriétaire reste inactif.
Pour pouvoir prescrire le propriétaire supposé doit apporter la preuve d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire (article 2229 du Code civil). La possession doit se poursuivre pendant trente ans pour conduire à l'usucapion.
La possession légale utile pour prescrire ne peut s'établir que par des actes d'occupation réelle et se conserve tant que son cours n'est pas interrompu ou suspendu (Cass. Civ., 15 mars 1977). L'interruption est possible si la commune a privé le possesseur de la jouissance du terrain pendant plus d'un an (article 2243 du Code civil). La commune peut interrompre la prescription en prenant des actes qui peuvent être matériels, c'est-à-dire relatifs à l'entretien du chemin (entretien des fossés, désherbage, empierrement, rebouchage des trous...), ou réglementaires, comme les arrêtés de police ( arrêtés limitant la voie en tonnage, instaurant un sens interdit...).
C'est au supposé propriétaire de fournir la preuve qu'il a rempli toutes les conditions posées par l'article 2229 du Code civil pour pouvoir prescrire. Pour la commune, il suffit donc de rechercher les actes qu'elle a pris depuis trente ans concernant le chemin rural contesté pour interrompre le délai de prescription.
En outre, la prescription ne joue pas lorsque le chemin est inscrit au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
La propriété communale est un critère important d'identification du chemin rural car un chemin, même affecté au public, s'il n'appartient pas à la commune, ne pourra pas être qualifié de chemin rural.
2 - Le chemin doit être affecté à l'usage du public.
L'affectation peut s'établir par la destination du chemin, jointe au fait d'une circulation "générale et continue" ou à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale (article L. 161-2 du Code rural) ;
. La destination : Elle peut être définie notamment par l'inscription du chemin sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Elle ressort de la localisation du chemin et de son rôle de communication entre les différentes voies ou lieux publics.
. L'usage effectif du chemin : il est apprécié au regard de la circulation et des actes de surveillance et de voirie des autorités municipales.
*La circulation : même si le Code rural exige une circulation "générale et continue", un usage quotidien n'est pas nécessaire. En effet, la circulation peut être occasionnelle et interrompue.
*Des actes réitérés de surveillance et de voirie : c'est un signe de la volonté de la commune de maintenir le chemin en état et donc de préserver son usage par le public. Il peut s'agir des actes d'entretien et de police.
3 - Le chemin ne doit pas avoir été classé au nombre des voies communales c'est-à-dire qu'il doit être demeuré dans le domaine privé de la commune.
LA CREATION DES CHEMINS RURAUX
Plusieurs situations se présentent pour la création des chemins ruraux :
- La création par transformation de chemins privés en chemins ruraux.
L'article L. 161-6 du Code rural prévoit que par délibération du conseil municipal sur proposition du bureau de l'association foncière ou de l'assemblée générale de l'association syndicale peuvent être incorporés à la voirie rurale :
- les chemins d'exploitation créés dans le cadre d'une opération de remembrement rural (articles L. 123-8 et L. 123-9 du Code rural) ;
- les chemins d'exploitation ouverts par les associations syndicales autorisées.
- La création par déclassement d'une voie communale existante tout en maintenant son affectation au public.
- La création d'un nouveau chemin.
Deux cas de figure se présentent :
- Si le tracé passe par une propriété privée, à défaut d'accord amiable, la commune aura recours à la procédure d'expropriation. Le juge administratif contrôlera alors la procédure d'enquête et l'existence de l'utilité publique (qui sera justifiée par l'affectation à l'usage du public). Cependant, l'opération perd son caractère d'utilité publique si, par exemple, le chemin ne dessert qu'une seule propriété ( C.E. 4 janvier 1954, Dame Veuve Raynier, R. 7).
- Si le terrain appartient déjà à la commune, il faut quand même que la délibération décidant la création du chemin rural soit précédée d'une enquête publique.
- La création lors d'une opération d'aménagement foncier (article L. 121-17 du Code rural).
L'intervention en la matière de la commission communale d'aménagement foncier, qui a une compétence de proposition et qui représente les diverses parties intéressées, dispense de la procédure d'enquête. Le conseil municipal indique à cette commission les chemins dont il estime la création nécessaire à l'intérieur du périmètre d'aménagement, puis il en décide par délibération expresse la création. Si la commune n'est pas propriétaire des terrains nécessaires à l'édification du chemin, elle devra indemniser les propriétaires.
LA MODIFICATION ET L'ELARGISSEMENT DU TRACE DES CHEMINS RURAUX
Le conseil municipal peut, après enquête publique, modifier le tracé d'un chemin rural par une délibération attributive de propriété de la ou des parcelles nécessaires à la nouvelle emprise moyennant indemnisation des propriétaires dépossédés. Un plan parcellaire doit être annexé à la délibération (articles L. 161-9 du Code rural et L. 141-6 du Code de la voirie routière).
Cependant, cette délibération n'entraîne l'appropriation de plein droit que si l'élargissement n'excède pas deux mètres ou si elle porte redressement dudit chemin*. En revanche, dès lors que l'élargissement est supérieur à deux mètres, le recours à la procédure d'expropriation est nécessaire.
Si la procédure (notamment l'enquête) n'est pas respectée, la prise de possession constitue une voie de fait.
La modification du tracé ou de l'emprise du chemin peut être proposée dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier par la commission communale d'aménagement foncier. Le silence du conseil municipal pendant deux mois vaut approbation de la modification. Cette procédure est dispensée d'enquête.
LA SUPPRESSION DES CHEMINS RURAUX
Le conseil municipal peut décider de la suppression du chemin rural par une délibération le désaffectant. Il peut le faire quand le chemin n'est plus utilisé (la circulation n'y est plus générale et continue ou l'état de la voie ne permet plus la circulation...),mais également si le chemin continue à être fréquenté. Une circulaire du 18 décembre 1969 incite d'ailleurs à aliéner les chemins devenus inutiles en raison de l'existence de voies en meilleur état ou plus commodes pour desservir les mêmes lieux.
La désaffectation ouvre la possibilité pour la commune d'aliéner le chemin, notamment en le vendant. La vente n'est d'ailleurs possible qu'après désaffectation. Une enquête publique préalable est cependant obligatoire.
La procédure d'enquête se déroule en plusieurs étapes :
- Le maire désigne par arrêté un commissaire enquêteur (qui ne peut être le secrétaire de mairie). Cet arrêté précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle elle sera ouverte ainsi que les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler des observations sur un registre ouvert à cet effet.
- Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute sa durée (quinze jours), l'arrêté du maire est publié.
- Une notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête à la mairie est adressée aux propriétaires des parcelles comprises dans l'emprise du projet (par lettre recommandée avec accusé de réception).
- A l'expiration du délai d'enquête, le registre est clos et signé par le commissaire enquêteur qui dans le délai d'un mois transmet le dossier, le registre et ses conclusions au maire.
- Après avoir recueilli les conclusions de l'enquête, le conseil municipal pourra prendre une délibération autorisant la vente même du chemin.
Une fois la vente décidée, celle-ci se fait selon les règles habituelles applicables à la vente des propriétés communales.
Remarques :
- Seule la vente est autorisée par le législateur et non l'échange ou la donation.
-Si dans les deux mois suivant l'ouverture de l'enquête préalable une association syndicale autorisée demande à se charger de l'entretien du chemin, la vente ne sera pas possible (l'association syndicale est autorisée par le préfet si elle regroupe soit lamajorité des propriétaires concernés représentant les deux tiers de la superficie des terrains, soit les deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de la superficie des terrains).
- Le conseil municipal doit préalablement à la réalisation de la vente mettre en demeure les riverains d'acquérir le terrain mis en vente attenant à leur propriété (article L. 161-10 du Code rural). Si cette mise en demeure n'est pas faite, la délibération du conseil municipal est annulée. Si, dans le délai d'un mois suivant cet avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé une offre ou si elle est insuffisante, l'aliénation du terrain est possible.
- Si le chemin est inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, toute aliénation n'est possible, sous peine de nullité, que si elle comporte la mise en place d'un chemin de substitution approprié à la pratique des promenades et des randonnées.
Si la suppression intervient dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier, des règles particulières s'appliquent :
* Il appartient à la commission communale d'aménagement foncier de proposer au conseil municipal la suppression d'un chemin. Celui-ci s'il ne se prononce pas dans un délai de deux mois, est considéré comme ayant approuvé la suppression.
Cependant, si le chemin est inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, la décision du conseil municipal doit être expresse.
* Cette procédure est dispensée d'enquête.
LES RIVERAINS DES CHEMINS RURAUX
1 - La délimitation du chemin
Les limites des chemins ruraux sont fixées, soit par le plan parcellaire annexé à la délibération du conseil municipal portant ouverture ou modification des emprises du chemin, soit par la procédure du bornage (article R. 161-12 du Code rural).
A titre individuel, elles peuvent être constatées par un certificat de bornage délivré par le maire sous forme d'arrêté à toute personne en faisant la demande. S'il n'existe ni plan ni borne, ledit certificat est délivré au vu des limites de fait ou de droit.
Par ailleurs, en l'absence de tout moyen permettant de délimiter un chemin rural, il peut y être procédé par une délimitation à l'amiable : un géomètre expert dresse un procès-verbal de bornage. En application de l'article 646 du Code civil l'opération de bornage s'effectue à frais commun. A défaut d'accord, une action en bornage peut être intentée devant le tribunal d'instance.
Enfin, il convient de noter qu'aucune opération de construction, reconstruction ou installation de mur ou de clôture ne peut être effectuée à la limite des chemins ruraux sans qu'un certificat de bornage ait été préalablement demandé (article R. 161-12 du Code rural).
2 - Les charges des riverains (articles R. 161-20 à R. 161-24 du Code rural)
Les propriétés riveraines des chemins ruraux doivent supporter un certain nombre de charges. Ainsi, par exemple :
- Les riverains ont des obligations destinées à assurer la conservation du chemin, à sauvegarder la sûreté et la commodité du passage. En particulier, ils doivent couper les branches et les racines qui avancent sur l'emprise des chemins. S'ils négligent ces travaux, ceux ci peuvent être réalisés par la commune à leurs frais après mise en demeure restée sans effet (article R. 161-24).
- Les riverains ont d'autres obligations en ce qui concerne les plantations (articles R. 161-22 et R. 161-23 du Code rural) et le curage des fossés (article R. 161-21).
- Les propriétés riveraines sont également assujetties à recevoir les eaux qui découlent naturellement de ces chemins (article R. 161-20).
3 - Les droits des riverains
S'ils ont des charges, les riverains disposent également de droits sur les chemins ruraux dont, notamment :
- un droit d'accès sur le chemin rural comparable à celui de toute personne dont la propriété jouxte une voie publique ;
- un droit de déversement des eaux ;
- un droit de vue ;
- un droit de préemption en cas de vente du chemin (article L. 161-10 du Code rural) ;
- un droit de réparation pour les dommages causés par le chemin.
L'ENTRETIEN DES CHEMINS RURAUX
A la différence des voies routières publiques, l'entretien des chemins ruraux ne constitue pas une dépense obligatoire pour la commune. Cependant, si cette dernière commence à prendre en charge cet entretien, elle devra continuer à l'assurer au risque sinon de voir sa responsabilité engagée (C.E. 20 novembre 1964, Ville de Carcassonne, R. 183).
Il en est ainsi notamment quand la commune a effectué des actes permettant la viabilité de ce chemin comme son
élargissement, l'empierrement, le goudronnage, le débroussaillage, le curage des fossés...
L'entretien peut également être pris en charge par un groupement de particuliers. Deux cas de figure se présentent :
- le chemin rural créé à la suite d'un remembrement peut être entretenu par une association foncière constituée entre les propriétaires des parcelles à remembrer (articles L. 123-8 et L. 123-9 du Code rural).
- le chemin peut être entretenu par une association syndicale (article L. 161-10 du Code rural)
Arrêté du 19 janvier 2010
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT
Arrêté du 19 janvier 2010 modifiant l'arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement NOR : DEVN0931712A
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu l'article L. 424-4 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 1er août 1986 modifié relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 6 janvier 2010,
Arrête :
Art. 1er. - L'article 7 de l'arrêté du 1er août 1986 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – pour la chasse collective au grand gibier, l'emploi d'émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques. »
Art. 2. - La directrice de l'eau et de la biodiversité est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 janvier 2010
Pour le ministre et par délégation :La directrice de l'eau bet de la biodiversité,
O. GAUTHIER
Pour mémoire voici l'arrêté du 1er août 1986 modifié,relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement(Journal officiel du 5 septembre 1986) Version mise à jour le 17 janvier 2007:
Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement,
Vu les articles 373 et 393 du code rural ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 1951 relatif aux réserves de chasse ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage,
Arrête :
Article 1er
Sont interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des animaux nuisibles :
-
l'emploi de la canne-fusil ;
-
l'emploi des armes à air ou gaz comprimé dénommées aussi armes à vent ;
-
l'emploi des armes à feu non susceptibles d'être épaulées sans appui ;
-
l'emploi de toute arme à rechargement automatique permettant le tir de plus de trois coups sans réapprovisionnement ;
-
l'emploi pour la chasse à tir d'autres armes ou instruments de propulsion que les armes à feu ou les arcs ;
-
à compter du 1er juin 2006, l'emploi de la grenaille de plomb dans les zones humides mentionnées à l'article L. 424-6 du code de l'environnement. Le tir à balle de plomb du grand gibier demeure autorisé sur ces zones. [A. du 9 mai 2005 – Jo du 31 mai 2005].
Article 2
Sont interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des animaux nuisibles :
- l'emploi de toute arme munie d'un dispositif fixe ou amovible comportant des graduations ou des repères de réglage de tir pour les distances supérieures à 300 mètres ;
-
l'emploi sur les armes à feu de tout dispositif silencieux destiné à atténuer le bruit au départ du coup ;
-
l'emploi de sources lumineuses et de miroirs de nature à faciliter la capture ou la destruction du gibier ;
-
l'emploi délibéré de tout dispositif électrocutant.
Article 3
Est interdit l'emploi pour le tir des ongulés de toute arme à percussion annulaire ainsi que celui d'armes rayées à percussion
centrale d'un calibre inférieur à 5,6 millimètres ou dont le projectile ne développe pas une énergie minimale de 1 kilojoule à
100 mètres.
Est interdit l'emploi des munitions destinées au tir dans les armes à canon lisse, dont la charge, constituée de grenaille de plomb ou d'acier, est disposée de telle manière qu'elle fait office de balle jusqu'à une distance pouvant atteindre 120 m et qui est conçue pour faire office de cartouche à grenaille après retournement du récipient qui la contient.
Article 4
Sont interdits pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles :
-
l'emploi dans les armes rayées d'autres munitions que les cartouches à balle expansive dont la vente est libre ;
-
l'emploi de toute munition chargée de grenaille de plomb d'un diamètre supérieur à 4 millimètres ou de grenaille sans plomb d'un diamètre supérieur à 4,8 millimètres. [A. du 9 mai 2005 – Jo du 31 mai 2005].
Les animaux des espèces suivantes : cerf, daim, mouflon, chamois ou isard et sanglier ne peuvent être tirés qu'à balle ou au moyen d'un arc de chasse conformément aux prescriptions de l'arrêté du 15 février 1995 relatif à l'exercice de la chasse à l'arc.
Toutefois, dans les départements présentant des formations de garrigues ou maquis, le ministre chargé de la chasse peut autoriser par un arrêté annuel, sur proposition du préfet, après avis du président de la fédération départementale des chasseurs les conditions dans lesquelles l'emploi de chevrotines est autorisé pour le tir du sanglier en battues
collectives.
Le chevreuil ne peut être tiré qu'à balle dans les départements suivants :
Ain, Aisne, Allier, Hautes-Alpes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Cher, Côted'Or, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Loire, Loiret, Loir-et-Cher, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse,Moselle, Nièvre, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône à l'exception des 56
communes incluses dans le périmètre de la communauté urbaine de Lyon, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Yvelines, Deux-Sèvres, Tarn,Var, Vendée, Vosges, Yonne, Essonne, Val-d'Oise. Corrèze : cantons d'Argentat, Ayen, Baynat, Brive Sud-Est, Brive Sud-Ouest, Donzenac, Juillac, Larche, Laroche-Canillac, Malemort, Meyssac, Vigeols ainsi que les communes de Hautefage et de Saint-Hilaire-Peyroux, qui jouxtent respectivement les cantons d'Argentat et Donzenac-Malemort.
Toutefois le chevreuil peut être tiré à l'aide d'un arc de chasse dans tous les départements conformément aux prescriptions de l'arrêté du 15 février 1995 relatif à l'exercice de la chasse à l'arc.
Article 5
Toute arme de chasse ne peut être transportée à bord d'un véhicule que placée sous étui ou démontée ; dans tous les cas l'arme doit être déchargée.
Tout arc de chasse ne peut être transporté à bord d'un véhicule que débandé ou placé sous étui.
Article 6
Est interdit en action de chasse et pour la destruction des animaux nuisibles, y compris pour le rabat, l'emploi :
-
de tout aéronef ;
-
de tout engin automobile, y compris à usage agricole ;
-
de tout bateau à moteur fixe ou amovible ;
-
de tout bateau à pédales, sauf dans les cas autorisés par le ministre chargé de la chasse.
L'utilisation d'embarcations à moteur est toutefois autorisée en période de crue pour la destruction à tir du ragondin et du rat musqué.
Article 7
( Modifié par l'arrêté du 15 juin 2005)
-
En application de l'article L. 424-4 du code de l'environnement, sont seuls autorisés pour la
-
chasse et la destruction des animaux nuisibles les moyens d'assistance électronique suivants :
-
- les dispositifs de localisation des chiens, dès lors qu'ils ne sont utilisés qu'après l'action de chasse dans le seul but de rechercher les chiens, ;
-
les appareils de repérage des rapaces de chasse au vol ;
-
les viseurs à point rouge, sans convertisseur ou amplificateur d'image, et sans rayon laser ;
-
pour la chasse de la bécasse des bois, les dispositifs de repérage des chiens qui marquent l'arrêt ;
-
les colliers de dressage de chiens ;
-
les casques atténuant le bruit des détonations ;
-
les lunettes à réticule lumineux fixées sur les armes à feu ;
-
les télémètres, à condition qu'ils ne soient pas intégrés dans une lunette de visée ;
-
les appareils monoculaires ou binoculaires à intensification ou amplification de lumière, à l'exclusion des appareils quipeuvent être mis en oeuvre sans l'aide des mains ;
-
les dispositifs permettant de capter les sons dans l'environnement des huttes de chasse, dits veilleurs de nuit.
Article 8
I. - Sont interdits :
-
la chasse à tir de la perdrix ou du faisan au poste, soit à l'agrainée, soit à proximité d'abreuvoirs ;
-
la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée ;
-
la chasse de la bécasse à la passée ou à la croule ;
-
le déterrage de la marmotte ;
-
l'emploi des chiens lévriers pur sang ou croisés ;
-
la chasse à tir des ongulés à proximité immédiate de dépôts de sel ou de dispositifs d'affouragement.
II. - Sont interdits :
1. Pour la chasse du chamois ou isard :
-
la chasse en battue ou traque, sauf dans les départements suivants : Ain, Haute-Savoie, Vosges ;
-
l'emploi des chiens, sauf dans les départements suivants : Haute-Savoie, Vosges.
2. Pour la chasse du mouflon : [suppression du Puy de Dôme par l'arrêté du 10 décembre 2007]
-
la chasse en battue ou traque, sauf dans les départements suivants : Alpes-Maritimes, Aveyron, Cantal, Dordogne, Gard, Hérault, Vosges ;
-
l'emploi des chiens, sauf dans les départements suivants : Aveyron, Dordogne, Gard, Hérault, Savoie, Vosges.
III. - La chasse du lapin peut être pratiquée à l'aide du furet. Toutefois son emploi est soumis à une autorisation individuelle délivrée par le préfet dans les départements suivants :
Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Ardèche, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côtes-du-Nord, Creuse, Dordogne, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Landes, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Morbihan, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques,
Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Haute-Savoie, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Haute-Vienne.
Article 9
L'emploi d'engins tels que pièges, cages, filets, lacets, hameçons, gluaux, nasses et de tous autres moyens ayant pour but d'effectuer ou de faciliter la capture ou la destruction du gibier est interdit sauf dans les cas autorisés :
1° Par le ministre chargé de la chasse :
-
pour la chasse des oiseaux de passage ;
-
pour la destruction des animaux nuisibles ;
[2° Abrogé par A. 7 juillet 2006 portant sur l'introduction et le prélèvement d'espèces dans le milieu naturel.]
Article 10
L'emploi de toxiques, poisons ou drogues est interdit pour enivrer ou empoisonner le gibier, sauf dans les cas autorisés :
1° En application du premier alinéa de l'article L. 427-8 du code de l'environnement ; [arrêté avril 2002].
2° En application des dispositions du code de la santé publique.
Article 11
[Abrogé par A. 7 juillet 2006 portant sur l'introduction et le prélèvement d'espèces dans le milieu naturel.]
Article 11 bis
Pour prévenir la destruction et favoriser le repeuplement des différentes espèces de gibier, il est interdit de le rechercher ou de le poursuivre à l'aide de sources lumineuses sauf dans les cas autorisés par l'autorité administrative pour les comptages et captures à des fins scientifiques ou de repeuplement. »
Article 12
[N'est plus en vigueur]
Article 13
Sont abrogés :
-
l'arrêté du 7 août 1959 relatif aux reprises de gibier vivant en vue de repeuplement ;
-
l'arrêté du 2 mars 1972 relatif à l'emploi des armes à feu pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles ;
-
toutes dispositions contraires au présent arrêté figurant dans les arrêtés réglementaires permanents sur la police de la chasse dans les départements.
Article 14
Le directeur de la protection de la nature est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er août 1986
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la protection de la nature,
F. LETOURNEUX